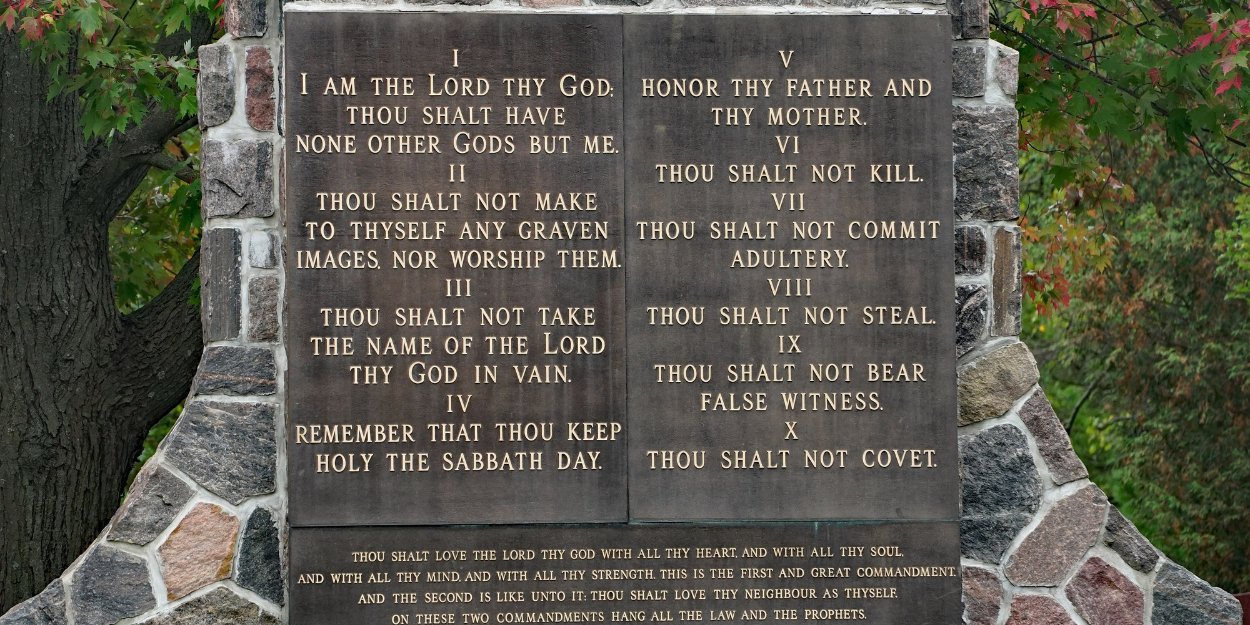La récente explosion de violence à Souweïda (sud de la Syrie) ravive d’anciens différends entre Druzes et Bédouins, nourris par des rivalités autour du contrôle des terres – champs cultivables, pâturages – mais aussi des routes de contrebande, notamment de drogue, devenues un moyen de survie local. Derrière cet affrontement, c’est une dynamique régionale plus large du Sud syrien qui se dessine, jusqu’aux confins de la Jordanie.
Cet arrière-plan avait éclaté au grand jour fin mars 2025 lorsqu’en direct à la télévision, un représentant bédouin interpella avec virulence le président Ahmed Hussein Al-Charaa, juste après la nomination du second gouvernement de transition, pour dénoncer l’absence de représentants du Sud. Al-Charaa lui répondit que le gouvernement comprend bien un ministre originaire du Sud : il s’agit en réalité d’un Druze de Souweïda, ce qui ne fait que confirmer la marginalisation ressentie dans d’autres composantes sociales du Sud.
Plusieurs épisodes de tensions violentes autour de la minorité druze avaient eu lieu depuis la chute du régime Assad, mais étaient restés contenus, en particulier des incidents entre les forces de sécurité (et forces affiliées) et les groupes druzes d’autodéfense à Damas (Jaramana, Ashrafiyyat Sahniyya) en avril 2025. Mais le niveau de violence atteint à partir du 11 juillet est inédit, avec représailles et exactions de part et d’autre et large mobilisation de groupes armés druzes et bédouins, occasionnant en quelques jours plus d’un millier de morts, des déplacements importants et des atrocités diverses, le tout sur fond de déchaînement de haine sur les réseaux sociaux.
L’épisode violent du Sud se déroule dans le contexte spécifique et fragile de la transition en Syrie après la chute inattendue du régime Assad et l’arrivée au pouvoir d’un groupe armé très spécifique du Nord-Ouest, Hayat Tahrir al-Cham (HTC). Cette transition, déjà extrêmement fragile, comme l’avait montré l’épisode des violences contre les alaouites sur la côte en mars 2025 (le rapport d’enquête sur ce massacre a été remis au président Al-Charaa le 13 juillet), est encore plus fragilisée par la violence extrême survenue à Souweïda. À cela s’ajoute un facteur régional de plus en plus pesant : alors que l’affaiblissement de l’Iran et du Hezbollah avait déjà précipité la chute du régime Assad, l’interventionnisme israélien dans cette crise locale devient désormais un élément central, et intrusif, de la transition.
Une poussée de violence qui touche au cœur de la transition
Contre toute attente, la transition syrienne amorcée en décembre 2024 avait jusqu’alors semblé relativement maîtrisée, en partie grâce à la communication habile du groupe HTC, nouvel acteur au pouvoir. Cette maîtrise du récit était d’autant plus cruciale que HTC, groupe armé issu du Nord-Ouest et marqué par une généalogie djihadiste (État islamique en Irak, Al-Qaida), avait officiellement rompu avec cet héritage. Il s’agissait de renouer avec l’élan initial de la révolution de 2011, fondée sur une mobilisation pacifique contre l’autoritarisme.
Des signaux d’alerte existaient pourtant. En mars 2025, de graves violences avaient été rapportées sur la côte syrienne, fief historique de la minorité alaouite, longtemps instrumentalisée par le régime Assad.
Parallèlement, un autre pilier du processus résidait dans la réintégration régionale et internationale de la Syrie nouvelle, rendue possible par une diplomatie proactive. Sur le plan économique, le régime avait donné les gages nécessaires pour obtenir la levée des sanctions américaines, puis européennes, qui asphyxiaient une économie exsangue.
Mais la Syrie se trouve à un point d’inflexion. Les mesures décidées et en cours pour la reconstruction politique interne du régime, dans le cadre de la période transitoire, suscitent de multiples méfiances, comme nous l’avons déjà souligné dans ces colonnes. En particulier, se posent des problèmes de reprise de contrôle par le centre (Damas) sur des espaces qui se sont autonomisés à la faveur de dynamiques complexes depuis 2011 – qu’il s’agisse de l’espace kurde ou de l’espace druze –, ainsi que sur des régions désormais périphéralisées qui avaient longtemps constitué des bastions du régime Assad, comme la région de la côte alaouite.
L’enjeu majeur, qui conditionnera in fine la réussite de la transition, est la réintégration à part entière de ces espaces dans une logique d’État syrien inclusif – et non dans celle d’un État affaibli, manipulé et démonétisé par des cliques se maintenant au pouvoir, comme ce fut le cas sous le pouvoir précédent pendant 54 ans.
La violence s’est déclenchée en juillet dans la province de Souweïda (à 90 % druze), territoire qui a conservé une trajectoire singulière depuis 2011. Maintenant une spécificité acceptée de facto sous le régime Assad, la région s’est essentiellement positionnée en retrait lors de la militarisation du soulèvement, sans pour autant échapper à la violence : en 2018, celle-ci est rappelée par une attaque sanglante de Daech – que certains attribuent au régime Assad, soucieux de signaler aux Druzes les limites de leur autonomie.
En 2023, une révolte civique éclate dans la ville de Souweïda. Elle est "tolérée" par un régime alors à bout de souffle, et se prolonge continûment jusqu’à sa chute. Depuis l’arrivée au pouvoir de HTC, Souweïda est parvenue à préserver son autonomie. Elle conserve aussi aujourd’hui plusieurs groupes armés druzes : certains se sont opposés militairement aux forces de sécurité du régime Assad entre 2018 et 2024 ; d’autres sont composés, au moins en partie, d’anciens militaires issus du régime depuis sa chute, y compris des officiers bien identifiés. Mais d’importantes factions druzes défendent désormais une réintégration dans le giron du gouvernement central à Damas, dans un environnement marqué par un factionnalisme druze très complexe.
Quel futur pour l’État central syrien dans cette région ?
Au-delà de la seule réintégration institutionnelle des territoires périphéralisés, c’est la question de l’identité même de l’entité syrienne en reconstruction qui se pose. Cette refondation de l’État doit permettre de réintégrer les différentes composantes de la société – notamment les sociétés civiles actives, comme celle de Souweïda – et les groupes autonomisés, le plus souvent armés, dans un cadre national commun.
Pour l’heure, l’identité dominante sous HTC reste celle d’un État musulman sunnite majoritaire, qui suscite la crainte de plusieurs communautés, confessions ou groupes. Quelques jours avant les événements de Souweïda, une tentative de médiation de haut niveau, fortement poussée par les États-Unis et la France, a échoué à établir un accord de réintégration avec les Kurdes des YPG-SDF, qui contrôlent toujours 25 % du territoire au Nord-Est. Cette dernière tentative marque même un recul par rapport aux avancées de l’accord du 10 mars 2025 entre YPG-SDF et Damas. Après les affrontements à Souweïda, les méfiances des YPG-SDF envers Damas risquent de se renforcer encore davantage.
Un test concret très important pour le nouvel État syrien sous la direction de HTC est la question des forces de sécurité et de l’armée, déjà controversée depuis les massacres d’alaouites sur la côte en mars. Il s’agit d’un problème classique des périodes de transition : reconstruire, dans le cadre de ce que l’on appelle en jargon la Security Sector Reform (SSR), des forces de sécurité réformées (police et armée), qui doivent exercer un rôle de protection de la population avec une certaine éthique, en s’éloignant de leurs origines miliciennes – et, pour certaines, d’une implication dans le racket ou le banditisme –, tout en écartant ou en punissant ceux qui sont impliqués dans des exactions contre les civils.
Dans le Sud, après le 11 juillet, les forces de Damas, associées à HTC et déployées comme force d’interposition entre groupes druzes et bédouins, ont été attaquées par des groupes druzes, soumises à des exactions, et ont répondu par d’autres exactions qui n’ont fait que renforcer l’unité des groupes druzes autour de leurs éléments les plus extrémistes. Ce type de crise permet (ou non…) de démontrer si le nouveau pouvoir est véritablement entré dans une logique étatique de stabilisation.
L’intervention israélienne de plus en plus intrusive
Israël avait déjà fait preuve d’interventionnisme sous le régime Assad, visant systématiquement et continûment les intérêts de l’Iran et du Hezbollah en Syrie. Après la chute du régime, il a intensifié ses actions, multipliant les frappes contre le matériel sophistiqué, l’aviation, les infrastructures et les sites de missiles laissés par l’armée d’Assad.
Les Druzes sont présents sur le plateau du Golan, occupé par Israël, qui a étendu ses avant-postes fortifiés sur le territoire syrien depuis la chute d’Assad. Ils vivent aussi en Israël, où une substantielle communauté a la citoyenneté israélienne. Politiquement actifs, ils représentent un groupe de pression influent, appuyé par leurs autorités religieuses. Les autorités israéliennes les considèrent comme une minorité loyale, participant au service militaire, y compris dans des unités d’élite ou de garde-frontières.
L’ingérence israélienne, justifiée par la protection des Druzes de Syrie, est dernièrement devenue beaucoup plus intrusive. Le gouvernement israélien s’est retrouvé pleinement impliqué dans la gestion de la crise de juillet entre Souweïda et Damas, notamment autour des négociations concernant le déploiement éventuel de forces militaires et de sécurité syriennes, en particulier la Sécurité générale, puis de forces plus légères, voire de forces locales druzes "en lien" avec ces forces venues de Damas.
Les propositions issues d’accords de cessez-le-feu, négociées entre acteurs de la société civile druze, chrétienne et autres notables à Souweïda avec Damas, ont été systématiquement dénoncées, quasi immédiatement après leur annonce, par certains groupes miliciens druzes proches du cheikh Al-Hijri, l’un des principaux leaders druzes. Ces dénonciations ont immédiatement été suivies de frappes israéliennes ciblant les forces de Damas et les groupes bédouins.
De manière inédite, pour faire pression sur Damas avant le deuxième cessez-le-feu – lui aussi violé – du 16 juillet 2025, Tel-Aviv a bombardé un bâtiment de l’état-major de l’armée syrienne en plein Damas, ainsi qu’une zone proche du palais présidentiel et des bases militaires au Sud. Ces bombardements visaient à imposer l’idée d’un second cessez-le-feu incluant le déploiement de forces locales druzes pour rétablir la sécurité, et non plus de forces de sécurité venues de Damas.
Un objectif possible d’Israël est la création d’une Syrie du Sud démilitarisée, ou d’un bastion druze soutenu par Israël, à l’image du modèle turc dans le Nord-Ouest entre 2015 et 2024 – zone d’où est issu HTC en décembre 2024 – avec des arrangements locaux et une administration informelle.
On peut aussi suspecter, au moins dans certains secteurs du pouvoir israélien, une volonté d’interventionnisme régional à grande échelle dans des États affaiblis ou détruits (par Israël), selon ses propres objectifs. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du « remodelage » inédit du Moyen-Orient présenté en 2024 par Benyamin Nétanyahou.
Elle se manifeste à Gaza, où Israël poursuit ses actions militaires sans jamais consentir à un cessez-le-feu, ainsi qu’au Liban, en Iran – notamment après la guerre directe entre les deux pays et la destruction (à confirmer) du programme nucléaire avec l’aide d’une intervention aérienne américaine – et en Syrie. Dans toutes ces zones, l’aviation israélienne contrôle largement l’espace aérien.
Dans le cas syrien, cette stratégie est même critiquée par l’envoyé de Trump pour la Syrie et ambassadeur en Turquie, Tom Barrack, qui a déclaré dans une interview à AP que l’intervention israélienne "crée un autre volet très confus".
Les conséquences plus larges d’une déflagration locale
L’épisode de Souweïda constitue un moment décisif pour la transition syrienne sous la direction de HTC, qui se trouve à la croisée des chemins : soit vers la reconstruction d’un véritable État, soit vers l’échec et l’effondrement du processus.
D’abord, le président Al-Charaa apparaît affaibli par son incapacité à stopper la violence qui a éclaté à partir d’un simple incident local. Or la « qualité » du leadership est un facteur clé dans toute transition. Certains éléments peuvent même contribuer à sérieusement le délégitimer. Ses soutiens lui reprochent notamment le blocus imposé par les forces militaires de HTC autour de la province de Souweïda. Ce blocus, qui visait à empêcher le renforcement des clans tribaux sunnites, a été perçu comme une capitulation devant les groupes druzes soutenus par Israël, notamment Hikmet Al-Hijri. Sur les réseaux sociaux comme Telegram, X ou Twitter, Al-Charaa est critiqué pour avoir fait de nombreuses concessions à Israël, qui impose un contrôle druze sur la province, accompagné du déplacement de nombreux Bédouins (environ 10 % de la population).
Ces critiques font le lien avec le positionnement antérieur très conciliateur adopté par les nouvelles autorités de Damas envers Israël, notamment le retour des dossiers personnels de l’espion israélien au cœur de l’État syrien Eli Cohen, pendu à Damas en mai 1965 ; le musellement des groupes armés palestiniens réfugiés à Damas ; les rencontres sécuritaires officieuses de haut niveau entre officiels syriens et le cabinet de sécurité israélien, notamment aux Émirats arabes unis ou à Bakou.
La dernière réunion le 12 juillet, quelques jours avant l’embrasement des événements de Souweïda, a été à tort perçue à Damas comme un feu vert pour mener une opération de maintien de l’ordre dans la région druze. Tout récemment, une première rencontre officielle a eu lieu à Paris le 24 juillet entre le ministre des affaires étrangères syrien et le ministre israélien des affaires stratégiques Dermer.
Ensuite, le déchaînement de violence sur le terrain – avec des corps suppliciés, pendus ou exhibés sur des pickups – et sur les mêmes réseaux sociaux a nourri le confessionnalisme. La logique de vengeance risque de transformer le cessez-le-feu en simple pause, plutôt qu’en étape vers la paix et la réconciliation/reconstruction.
Enfin, les forces civiles et civiques locales de Souweïda, qui ont toujours négocié avec Damas, se retrouvent affaiblies face aux groupes armés les plus durs cherchant à s’autonomiser par rapport à Damas.
Les mois à venir seront cruciaux pour le président Al-Charaa…
Philippe Droz-Vincent, Professeur agrégé en sciences politiques et en relations internationales. Spécialiste du monde arabe, Sciences Po Grenoble
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.