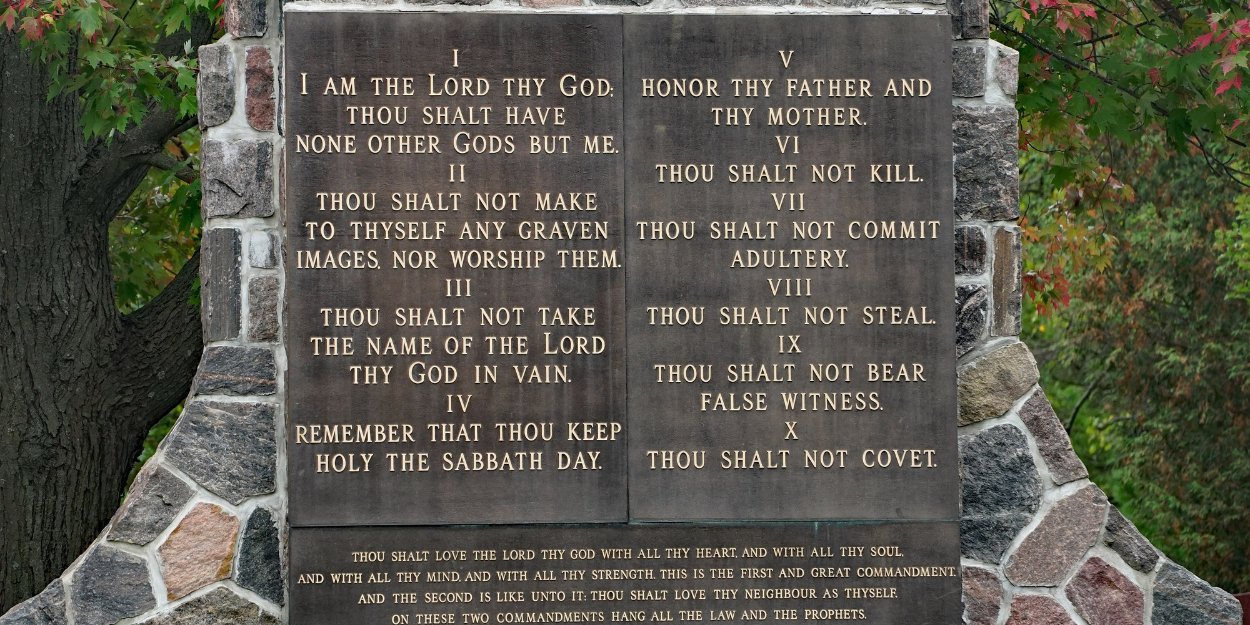La guerre en Ukraine a des répercussions géostratégiques importantes sur le Moyen-Orient et, notamment, sur le dossier kurde. Cette guerre concentre toute l’attention de la Russie et une grande partie de celle des États-Unis, et rend donc ces deux acteurs moins enclins à s’opposer fermement aux opérations conduites par la Turquie contre le PKK (parti marxiste-léniniste pankurde). En outre, le contexte actuel contribue à créer une convergence objective entre Ankara et Téhéran sur la question kurde.
Quand Ankara et Téhéran s’en prennent simultanément aux groupes kurdes
La recherche d’un dialogue entre les puissances occidentales et Téhéran n’est plus à l’ordre du jour.
Les Occidentaux fustigent l’Iran pour son inflexibilité sur le dossier nucléaire et son engagement aux côtés de la Russie en Ukraine, qui s’est matérialisé par la livraison de drones à Moscou.
De son côté, Téhéran dénonce l’ingérence des puissances occidentales dans ses affaires intérieures (puisque ces puissances critiquent avec véhémence la répression du mouvement de contestation qui traverse le pays depuis le meurtre de la jeune Kurde Mahsa Amini) et le rôle déstabilisateur des États-Unis qui affichent leur soutien à l’opposition iranienne – à savoir les monarchistes, les Moujahidines du peuple (comme composante politique identifiée) et aussi les manifestants actuels à l’intérieur du pays.
Pendant ce temps, la Turquie met à profit le contexte de la guerre en Ukraine, qui lui a permis de renforcer son influence diplomatique, pour mener une offensive militaire en Syrie contre les forces kurdes affiliées au PKK. La branche syrienne du PKK, le Parti de l’union démocratique (PYD), domine les Forces démocratiques syriennes, structure militaire hétéroclite composée de plusieurs dizaines de milliers de combattants.
Depuis le 20 novembre, Ankara conduit une suite d’opérations militaires qui ont pris la forme d’une série de raids aériens et de tirs d’artillerie contre les positions en Syrie et en Irak du PKK, tenu pour responsable de l’attentat à la bombe qui a fait six morts à Istanbul le 13 novembre. La Turquie prépare ses forces terrestres à un engagement majeur dans le nord de la Syrie.
La Turquie riposte à l’attentat d’Istanbul en frappant les régions kurdes de Syrie et d’Irak, France 24, 20 novembre 2022.
Téhéran, de son côté, a frappé les positions militarisées dans le Mont Qandil (non nord-ouest de l’Irak) de plusieurs organisations kurdes – le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI), le Parti pour une Vie Libre au Kurdistan (PJAK, branche iranienne du PKK) et Komala (Organisation autonomiste kurde (de tendance maoïste). Ces groupes sont accusés par Téhéran d’attiser les manifestations contre le régime consécutives à la mort de Mahsa Amini.
Ces nouveaux développements démontrent que si, historiquement, la question kurde renvoie à une diversité de réalités et d’intérêts, le sentiment identitaire qui déborde les frontières et la trajectoire de certains mouvements indépendantistes, ainsi que leur alliance devenue inextricable avec les États-Unis, fédèrent les deux principaux acteurs régionaux dans leur volonté de neutraliser la « menace intérieure kurde ».
La passivité américaine
Voilà près de 40 ans que des épisodes d’affrontements rythment l’histoire conflictuelle entre le PKK, créé en 1978 par Abdullah Öcalan (et inscrit depuis 1997 sur la liste américaine des organisations terroristes), et les autorités turques. Le conflit armé, qui débute en 1984 et atteint son paroxysme dans les années 1990, est passé par plusieurs phases. Après une période d’accalmie à la fin de l’année 2012, faisant suite à des négociations entre les autorités turques et le PKK, le conflit s’intensifie de nouveau à partir de 2015.
À la faveur de la guerre en Syrie et des évolutions sur le terrain, le PYD a connu une montée en puissance qui a accru les appréhensions d’Ankara. Pour la Turquie, cette force incarne une menace pesant sur son intégrité territoriale et son unité nationale puisque le projet du PKK (dont le PYD, nous l’avons dit, est la branche syrienne) est de créer un État kurde en séparant le Kurdistan de Turquie du reste du pays.
Fer de lance de la lutte contre le groupe État islamique, le PYD est soutenu par les États-Unis, même si ceux-ci cherchent dans le même temps à ménager leur allié stratégique turc. Pour ne pas heurter la Turquie et appuyer de manière directe le PYD, Washington a favorisé la création des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition hétéroclite qui reste perçue par Ankara comme une structure-écran dominée par le PKK, et qui contrôle le Nord-Est de la Syrie. Cette alliance fluctuante au gré des contextes et de la redéfinition des priorités américaines est d’abord conçue dans l’intérêt des États-Unis.
Les FDS se sont, en effet, retrouvées dans un rapport de dépendance élevé à l’égard de Washington. Plusieurs épisodes du conflit en Syrie ont illustré la faiblesse de la garantie de sécurité américaine, à l’exemple des batailles de Manbij en 2016 et d’Afrin en 2018 où les Kurdes ont été les otages des calculs américains, et traités davantage comme des partenaires circonstanciels que comme des alliés stratégiques.
L’opération militaire lancée par le président turc le 20 novembre pour neutraliser la menace kurde dans les zones syriennes situées le long des frontières méridionales de la Turquie en refoulant les YPG (bras armé du PYD) à près de trente kilomètres de la frontière turque a ravivé les inquiétudes des forces kurdes, qui craignent que la Turquie ne bénéficie une nouvelle fois de la mansuétude de Washington.
Le commandant général des FDS, Mazloum Kobane Abdi, a en effet demandé aux États-Unis d’adopter une position plus ferme « face aux menaces turques ». Il a également appelé la Russie – qui avait joué un rôle de médiateur lors de la précédente offensive turque en 2019 et obtenu un accord en vertu duquel l’armée syrienne et des forces russes se sont déployées le long de la frontière – à faire pression sur la Turquie.
Cette opération militaire de la Turquie pour sécuriser ses zones frontalières est toutefois perçue par les observateurs occidentaux comme s’inscrivant dans un agenda électoral : il s’agit de renforcer la position de l’AKP dans la perspective des prochaines échéances électorales, après sa défaite en 2019 aux élections locales à Izmir, Istanbul et Ankara sur fond de profonde crise économique.
Mais pour Bayram Balci, directeur de l’Institut français d’Études anatoliennes (IEFA), joint par téléphone, cette offensive militaire ne relève pas uniquement de l’instrumentalisation politique et obéit à un réel souci sécuritaire : « Les considérations de politique intérieure sont très importantes, les autorités turques veulent montrer que les responsables de l’attentat d’Istanbul ne sont pas restés impunis, et probablement également obtenir de meilleures chances de remporter les élections. Mais malgré cela, il y a une réalité dont nombre d’analystes ne veulent pas tenir compte : cette opération revêt un intérêt sécuritaire réel face à la menace que représente pour la Turquie la présence des milices kurdes à sa frontière. »
Bayram Balci estime que si jusque là ni les Russes, ni les Américains ne veulent d’une incursion militaire terrestre de la Turquie en Syrie, ils tolèrent toutefois les bombardements aériens et les tirs d’artillerie dans la mesure où ils « n’ont pas les moyens d’entrer en conflit avec Ankara et ont besoin d’elle dans le conflit en Ukraine ».
Pour Igor Delanoë, directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe à Moscou, contacté également par téléphone, les Russes sont hostiles non pas aux Kurdes en tant que tels mais à leur alliance militaire avec les États-Unis, qui continuent de garder sous leur contrôle la rive orientale de l’Euphrate : « Moscou a régulièrement critiqué cette présence américaine et appelé les Kurdes à rompre cette alliance. Rien n’indique à ce stade que les FDS vont troquer leur allégeance aux Américains contre un retour dans le giron de Damas. Les Russes ont manifestement poussé pour que les Kurdes évacuent la bande de 30 km attenante à la frontière avec la Turquie dans les zones sous leur contrôle, mais cela n’a rien donné. Maintenant, il est vrai que l’entêtement des Kurdes à privilégier leur alliance avec Washington irrite les Russes. Mais cela ne va pas au-delà. »
Une nouvelle donne appelée à durer ?
Du côté de Washington, bien que le durcissement de ton à l’égard la Turquie pour tenter de dissuader Recep Tayyip Erdogan de lancer la phase terrestre de l’offensive augure d’un raidissement de la position américaine, les moyens de pression restent limités en raison de l’importance du rôle de la Turquie dans le conflit en Ukraine.
Sur ce dossier, Ankara tient une position ambivalente. D’une part, elle a contribué à l’effort de guerre de ses alliés de l’OTAN. D’autre part, elle continue de bloquer la tentative de l’OTAN d’accélérer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Alliance en dépit des sollicitations américaines. Ankara est l’un des deux seuls pays membres de l’OTAN, avec la Hongrie, à ne pas avoir donné son aval à l’adhésion des pays nordiques. Washington dispose donc de peu de leviers de pression contre la Turquie dans ce contexte.
Quant à l’Iran, s’il n’a pas d’antagonisme majeur avec les FDS en Syrie, et ne semble pas résolument hostile au PKK en Irak, il est aujourd’hui, nous l’avons dit, engagé dans une confrontation militaire avec le PDKI, le PJAK et Komala, considérés parmi les forces motrices du soulèvement actuel contre le régime (soulèvement au moins partiellement imputé à Washington).
Une nouvelle donne s’esquisse donc : la convergence de la Turquie et de l’Iran qui voient désormais les acteurs kurdes comme des auxiliaires d’une stratégie américaine de déstabilisation. Les grandes puissances ayant à fort à faire ailleurs, les Kurdes risquent de ne pouvoir compter que sur leurs propres ressources pour faire face à cette double offensive…
Lina Kennouche, Docteur en géopolitique, Université de Lorraine
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.