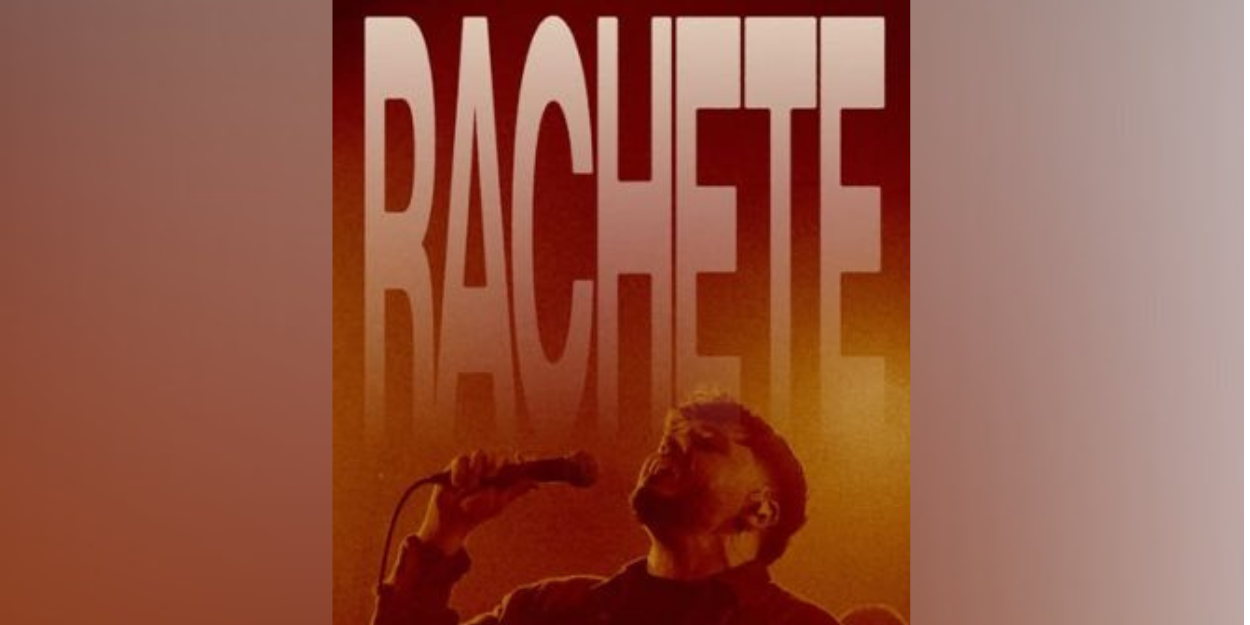En Guinée, l’interminable attente du procès des responsables présumés du massacre du 28 septembre 2009, si souvent annoncé puis reporté, a pris fin le 28 septembre 2022.
Précisément 13 années après les faits a commencé à Conakry le jugement d’anciens responsables militaires et gouvernementaux de la junte alors en place, le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD).
Au total, 13 personnes ont été mises en examen et renvoyées devant la justice pénale guinéenne pour y être jugées. Seules 12 comparaissent actuellement, le général Mamadouba Toto Camara, numéro 2 du CNDD, étant décédé en 2021. Parmi elles, figurent notamment le capitaine Moussa Dadis Camara, chef du CNDD, ainsi que son aide de camp et chef de la garde présidentielle, le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité (dit Toumba).
Treize années d’attente
Rappelons que le 28 septembre 2009, un meeting de l’opposition avait tourné au drame dans la capitale guinéenne. Alors qu’une foule d’opposants s’était réunie dans le stade de Conakry pour manifester contre la candidature à l’élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, les forces de sécurité avaient réprimé brutalement le rassemblement.
[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]Signe de la portée du procès, son ouverture s’est déroulée en présence du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, lequel a insisté sur l’importance de la crédibilité d’une procédure équitable qui soit à la hauteur de l’attente des victimes et ne se résume pas à un effet d’annonce.
La Guinée, qui a ratifié le Statut de Rome en 2003, fait depuis octobre 2009 l’objet d’un examen préliminaire de la CPI sur les crimes commis le 28 septembre 2009, mais aussi sur l’existence et l’authenticité de procédures nationales relatives à ces crimes.
Au cours des 13 dernières années, le Bureau du Procureur de la CPI s’est efforcé de dialoguer avec les autorités guinéennes pour qu’elles honorent leur promesse de rendre justice dans cette affaire dans le cadre d’une « complémentarité positive » avec la CPI, cette dernière n’ayant vocation à agir que si les tribunaux nationaux n’ont pas la capacité ou la volonté de juger. Autrement dit, même lorsqu’il y a capacité, encore faut-il que la volonté soit réelle. À cet égard, Karim Khan a annoncé que l’ouverture du procès, sous réserve qu’il aboutisse, marquerait la fin de l’examen préliminaire engagé.
Une avancée et une surprise
Le début du procès du massacre du 28 septembre 2009 constitue à la fois une avancée majeure et une surprise.
Il s’agit d’une avancée majeure, parce que c’est la première fois en Guinée, depuis l’indépendance en 1958, que de hauts responsables politiques et militaires sont jugés par un tribunal pour des faits qualifiés d’assassinats, meurtres, viols et violences sexuelles, actes de torture et violences, séquestration et pillage commis sur la population civile.
La qualification de crime contre l’humanité n’a pas été retenue. Cependant, les infractions de droit commun figurant dans l’ordonnance de renvoi des juges d’instruction couvrent bien les événements survenus au stade de Conakry, au cours desquels au moins 156 personnes ont été tuées, 109 femmes ont été victimes de viols et d’autres violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles, tandis que des centaines de personnes ont subi des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’avancée est incontestable, compte tenu de l’impunité dont ont toujours bénéficié dans ce pays les auteurs de violations des droits humains. Le dossier de la procédure a été transmis par la Cour suprême à un tribunal criminel constitué pour l’occasion ; des magistrats disponibles ont été désignés ; des avocats sont présents pour assister les victimes et défendre les prévenus ; les 12 prévenus comparaissent en personne ; une salle neuve et spacieuse a été spécialement dédiée à la tenue du procès ; le jugement est public et la presse y assiste. Les conditions semblent donc réunies, du moins en apparence, pour la tenue d’un véritable procès « historique ».
Le début du procès constitue également une surprise. Depuis 2017, date de la fin de l’information judiciaire sur le massacre, il se dégageait l’impression qu’aucun gouvernement en Guinée ne souhaitait réellement la tenue d’un tel procès, aux possibles répercussions politiques. Les proches du président Alpha Condé (en poste de 2010 jusqu’au coup d’État qui a provoqué sa chute en 2021) justifiaient souvent la non-organisation du procès par le fait qu’il risquerait de déstabiliser l’institution militaire (dont sont issus tous les accusés) et provoquer une crise dans la région de la Guinée forestière dont est originaire le capitaine Moussa Dadis Camara (et où il conserve influence et réseaux). En outre, certains des accusés (les colonels Claude Pivi et Moussa Tiégboro Camara) avaient conservé leur poste dans l’appareil d’État guinéen, que ce soit au sein de l’équipe de la garde présidentielle ou dans celle en charge de la lutte contre le grand banditisme.
Le calendrier de l’organisation du procès s’est cependant subitement accéléré en juillet 2022, après le feu vert donné par le colonel Mamady Doumbouya, à la tête du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) depuis le coup d’État qui l’a porté au pouvoir en septembre 2021.
La justice guinéenne au révélateur
Quant au procès lui-même, il constitue un défi à relever pour la justice guinéenne, moins connue pour ses forces que pour ses faiblesses : désorganisation, corruption, lenteur, faible niveau de formation des magistrats, manque de moyens, interférences politiques.
À cet égard, la décision d’emprisonnement des cinq accusés encore libres – dont le capitaine Moussa Dadis Camara, les colonels Claude Pivi et Moussa Tiégboro Camara et l’ex-ministre de la Santé Abdoulaye Cherif Diaby – semble démontrer que le tribunal entend ne pas se laisser impressionner.
Toutefois, la conduite d’un tel procès inédit en Guinée – et guère préparé au vu de l’accélération subite du calendrier depuis juillet 2022 – risque d’être difficile à mener à bien tant au regard de la personnalité des accusés que du nombre de victimes (plus de 500), de la gravité des faits examinés et du manque d’expérience de la justice guinéenne en la matière.
Comment les témoins et les victimes seront-ils protégés par les autorités nationales durant et après le procès ? Comment les victimes seront-elles indemnisées ? Le procès ne va-t-il pas s’étirer en longueur, à la faveur des multiples renvois et compléments d’information qui seront immanquablement sollicités ? Comment les magistrats, peu formés, pourront-ils prendre la mesure de ces faits et rédiger une décision qui réponde aux standards internationaux ? Vont-ils réunir à incarner ce tribunal indépendant, impartial et compétent qui est requis pour ce type d’affaires ? Le colonel Mamady Doumbouya, déjà critiqué pour l’emprisonnement de membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), un mouvement issu de la société civile réclamant le respect des règles démocratiques, ainsi que pour la répression des manifestations de ses partisans à Conakry, va-t-il maintenir dans le temps son engagement en faveur de la tenue du procès ? Autant de questions qui inquiètent la communauté internationale et les ONG qui soutiennent la tenue de ce procès.
Un procès incomplet ?
Un dernier point, et non des moindres, suscite des inquiétudes. L’information judiciaire n’a pas permis la constitution d’un dossier complet et détaillé sur les faits qui ont eu lieu au stade de Conakry le 28 septembre 2009 et dans les jours qui ont suivi. Les trois juges d’instruction guinéens – qui ont enquêté entre 2012 et 2017 – ont collecté des auditions de victimes, de témoins et des accusés, mais aucune preuve scientifique ou matérielle de l’implication des accusés dans les faits du massacre du stade. Ils n’ont pas dressé non plus une chronologie précise des faits, ni établi la chaîne de commandement alors en place – ce qui a d’ailleurs, et de manière inexpliquée, abouti à ce que nombre des acteurs du massacre ne soient jamais inquiétés et renvoyés devant le tribunal.
Une telle situation trouve son origine dans la carence des moyens des juges d’instruction et de la police judiciaire qui les a assistés, mais aussi dans le défaut de professionnalisme des juges d’instruction, qui n’ont pas exploité les informations dont ils disposaient, notamment à la suite des rapports de la Commission d’enquête des Nations unies et des rapports des ONG Human Rights Watch et Fédération internationale des droits de l’homme. La tenue de l’actuel procès permettra-t-elle d’y voir plus clair et d’établir les responsabilités des uns et des autres ? Si nul ne le sait aujourd’hui, la tâche s’annonce indubitablement ardue.
Catherine Maia, Professeure de droit international à l’Université Lusófona de Porto (Portugal) et professeure invitée à Sciences Po Paris (France), Sciences Po
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.