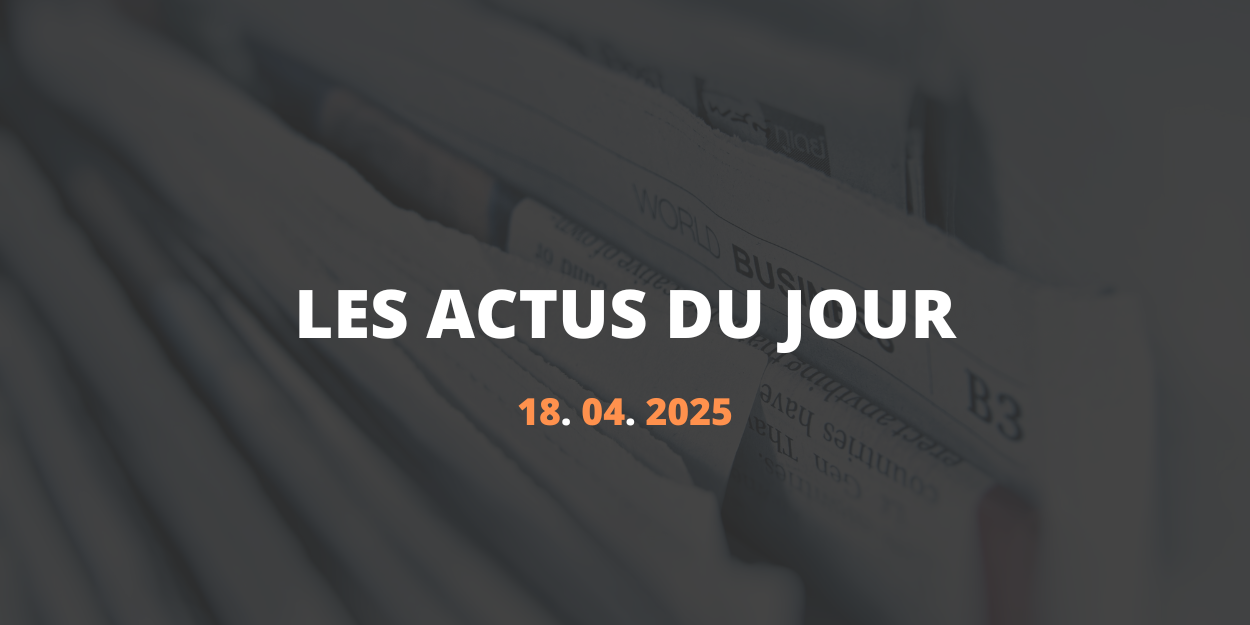À l’occasion de l’année de la bande dessinée, et alors que l’on fête ce 28 février les 63 ans du recrutement de Gaston Lagaffe dans le journal Spirou, on peut s’interroger sur la façon d’être de l’un des plus célèbres « olibrius » de la bande dessinée.
Et si ce gaffeur patenté était en réalité atteint d’une maladie rare du tissu conjonctif ? À bien l’observer, on peut en effet déceler chez lui un ensemble de symptômes caractéristiques du Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED). À deux jours de la journée internationale des maladies rares, le 29 février, faisons le point sur cette maladie du tissu conjonctif et ses conséquences sur le célèbre « héros sans emploi ».
Un tissu de soutien omniprésent
Ni tissu musculaire, ni tissu nerveux, ni tissu de revêtement, le tissu conjonctif est constitué de cellules non jointives (comme les cellules graisseuses, les fibroblastes, etc.), de fibres (élastiques et collagènes) et de la substance fondamentale (l’association des fibres et de cette dernière constitue la matrice extracellulaire). On peut le classer en fonction de la quantité et de la nature de ses constituants (fibres, cellules, eau…), dont la variété lui confère différentes propriétés : par exemple, une résistance mécanique ou des capacités d’échange métabolique.
En clair, le tissu conjonctif est un tissu de soutien qui maintient les autres tissus ensemble, assure la cohésion des organes, et leur sert « d’emballage ». Il n’est donc pas surprenant qu’il représente 70 à 80 % de la masse du corps humain, et qu’on le trouve partout : dans les muscles, la peau, les nerfs, les os, les parois des vaisseaux sanguins, les yeux… Reste que sa qualité et sa quantité sont variables suivant les organes : il est ainsi peu présent dans le cerveau, mais son collagène est très abondant dans le muscle – d’où la formation de gélatine au-delà d’une température de 60 °C, et donc lors de la cuisson d’un pot-au-feu.
Un syndrome multiforme
C’est parce que le tissu conjonctif est présent dans nombre d’organes que le Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) l’affectant rassemble sous un terme générique plusieurs maladies différentes. Mais la communauté scientifique et médicale a proposé plusieurs classifications, en fonction des manifestations cliniques, pour tâcher d’y voir plus clair et proposer une prise en soin adaptée.
Tous les SEDs se caractérisent par une hyperextensibilité cutanée, une hypermobilité articulaire, et une fragilité tissulaire source de difficultés de cicatrisation. Ils ont fait l’objet d’une première classification à Berlin en 1988, puis d’une seconde en 1997, mais celles-ci ne parvenaient pas à circonscrire tout leur spectre, les critères diagnostiques n’étant pas toujours pertinents. Une autre classification internationale a donc été proposée (classification dite de New York), voilà bientôt trois ans, avec 13 sous types de SEDs.
Chacun d’entre eux, à l’exception du type hypermobile (SEDh), correspond à une entité nosologique distincte et définie par des mutations d’un seul ou d’un petit ensemble de gènes, d’où un diagnostic très fiable. En revanche, faute de gènes incriminés et donc de test génétique, le diagnostic du type hypermobile s’appuie sur un faisceau d’arguments cliniques, bien que les symptômes soient multiples, hétérogènes, et que les atteintes et répercussions fonctionnelles puissent prendre de nombreuses formes. Certaines manifestations cliniques peuvent ressembler à des manifestations somatoformes, c’est-à-dire sans causes identifiées avec certitude.
Trois critères diagnostiques
Le SEDh est apparemment la forme la plus fréquente des SEDs : les estimations vont pour la France de 1 personne sur 5000 à 1 sur 20 000. Or cette prévalence semblant augmenter depuis 2012, la communauté médicale a pointé la nécessité de disposer de critères précis – pour éviter les diagnostics erronés et les errances diagnostiques. En l’absence de confirmation génétique possible actuellement, le diagnostic se fait par un médecin spécialiste en s’appuyant sur la présence concomitante de plusieurs faisceaux d’arguments et signes cliniques présents (classification de New York).
Le premier d’entre eux est une hypermobilité articulaire généralisée, qui peut être évaluée par le score de Beighton. Cet examen s’appuie sur cinq manœuvres cliniques cotées sur 9 points.
– La dorsiflexion passive de l’articulation métacarpophalangienne du 5ᵉ doigt (auriculaire) au-delà de 90° (1 point pour chaque main)
– L’hyperextension du coude au-delà de 10°(1 point pour chaque coude)
– L’apposition passive des pouces sur la face antérieure de l’avant-bras (1 point pour chaque pouce)
– L’hyperextension du genou au-delà de 10°(1 point pour chaque genou)
– Une flexion du tronc vers l’avant, les genoux complètement étendus, de sorte que les mains reposent à plat sur le sol lors (1 point)
L’hypermobilité articulaire est reconnue pour un score de Beighton à 4 ou 5, selon les auteurs et l’âge du patient.
Un second point doit néanmoins être examiné. A savoir la présence de deux indices à choisir entre l’atteinte systémique du tissu conjonctif, les complications musculo-squelettiques, l’atteinte cutanée, et l’histoire familiale. On prêtera ainsi une attention particulière à une peau extraordinairement douce ou veloutée, une hyperextensibilité cutanée, un rapport envergure des bras sur hauteur important (supérieur ou égal à 1,05), des douleurs chroniques, des complications musculo-squelettiques, une instabilité franche des articulations (luxation/subluxation), etc. Enfin, troisième point important, les manifestations cliniques ne doivent pas être expliquées par un autre diagnostic ou une autre forme de SED.
Le diagnostic de SEDh est donc porté si les 3 points sont réunis. Le tableau clinique est souvent associé à une fatigue chronique et des douleurs (parfois liées aux instabilités articulaires), qui peuvent altérer la qualité de vie. S’y ajoutent parfois d’autres signes cliniques – frilosité, reflux gastro-œsophagien, transpiration excessive, etc. – qui ne sont pas, toutefois, des critères diagnostiques.
A la lumière d’une nouvelle édition intégrale…
La lecture de cette description clinique n’est pas sans nous interroger sur Gaston Lagaffe, l’un de nos antihéros préférés. En 2017, une édition intégrale recolorisée est sortie regroupant par ordre de numéros croissants les gags de Gaston. Cette édition nous permet d’illustrer les probables critères diagnostiques du SEDh chez lui.
Dans son cas, le critère de fatigue chronique n’est plus à démontrer : il est de notoriété publique ! Ainsi, en feuilletant les pages de l’intégrale, il n’est pas rare de voir Gaston s’endormir debout, même en « sursaut » (gags 110b, 114, 130b, pages 93,91 et 112) ou lors d’une apnée prolongée (gag 239 page 182). Cette fatigue et son hypersomnie avaient fait penser à certains que Gaston pouvait être narcoleptique. Mais ne sont-elles pas plutôt en lien avec un SEDh ? Qu’en est-il des autres critères diagnostiques chez notre gaffeur ?
On le sait, Fantasio considère que Gaston n’est pas souple (gag 135a page 120) mais « mou ». Reste que tout au long de l’œuvre de Franquin, on décèle aisément chez Gaston une hypermobilité articulaire. Ses amplitudes articulaires sont en effet très importantes, allant même au-delà des possibilités physiologiques. De plus, bien que les genoux et les coudes fléchis soient ses positions préférées, ses articulations sont parfois capables d’hyperextension, par exemple lorsqu’il joue au football.
Un score de Beighton entre 5 et 9 !
En l’absence d’examen clinique formel, il est évidemment compliqué de réaliser un score de Beighton. Mais au vu des différentes planches des gags, on peut l’estimer à 5, voire 7 ou 9. On note en effet une flexion à plus de 90° des auriculaires (2 points, gag 740 page 672), lorsque notre Gaston devenu gardien de but se relâche. Mais on observe aussi une hyperantéflexion du tronc importante (dessin de couverture pour la reliure du journal de Spirou n°85 parue en 1963 et gag 26b page 39), des mains qui reposent à plat sur le sol lors d’une flexion de tronc vers l’avant (1 point, gag 26b page 43 et gag 536b page 548), des hyperextensions de coudes passif à droite (gag 859 page 798) et à gauche (gag 875 page 814, 860) soit un total de 5 points.
Certes, l’hyperextension – ou recurvatum – du genou chez Gaston est plus discutable. Mais un coup du foulard infligé par Lebrac lors d’un match de rugby (gag 716 page 648), ainsi qu’une chute dans les escaliers (gag 536b page 448) ou un saut avec un cerf-volant (gag 577b page 499) en attestent (2 points), portant le score de Beighton à 7 points. Enfin, s’il n’existe pas d’illustration formelle, on doit admettre au vu de scènes évocatrices (comme le gag 159b page 132) qu’il existe chez Gaston un probable signe du pouce (à droite et à gauche, 2 points), ce qui pourrait porter le score à 9 points.
Cette hypermobilité articulaire est bien illustrée dans le calendrier de 1967 dessiné par Franquin (on y voit Gaston se contorsionner pour regarder les mois du calendrier), ou encore dans le gag 283 (page 208) où notre antihéros s’emberlificote avec son homologue en latex. Cette laxité permet à notre garçon de bureau de se mettre dans des positions invraisemblables, comme lorsqu’il joue du trombone à coulisse dans une cabine téléphonique (gag 570b page 486), ou quand il se cache pour dormir dans son armoire (gag 237 page 181). Fantasio profite de cette particularité articulaire pour glisser Gaston dans des tiroirs (gag 27b page 44, gag 125b page 109).
Il semble bel et bien présenter tous les critères
S’agissant du deuxième point nécessaire pour poser un diagnostic de SEDh, plusieurs constats peuvent être faits. Il y a d’abord chez Gaston une hyperextensibilité cutanée, qui lui permet d’utiliser un Mastigaston® (Mastigaston page 138), mais aussi une peau douce et veloutée que met en évidence la restauration des couleurs de Frédéric Jannin dans l’intégrale des gags parue en 2017. C’est d’ailleurs sa peau de pêche (voir la couverture et la page de garde de l’album “le repos du gaffeur” pages 494 et 495) qui permet à Lagaffe de devenir modèle pour une publicité de PetroleScalp® (gag193 page 154).
Ensuite, on note chez Gaston un rapport bras/jambes supérieur à 1,05 (particulièrement bien illustré dans le gag 364, page 255). De plus, il est capable de recouvrir son pouce dans sa paume avec ses autres doigts, de manière bilatérale, ce qui peut témoigner d’une arachnodactylie : il n’est qu’à le voir pratiquer le bicyclown (gag 877 page 816) et sa façon de tenir la corde à sauter. Et Gaston, tout au long de l’oeuvre de Franquin, est également sensible aux ecchymoses, bosses ou cicatrices étranges après des chocs et autres traumatismes sportifs ou de bureau (par exemple gag 877 page 816). Il s’en protège avec toutes sortes de dispositifs anti-chute : en s’enroulant dans un matelas (page 236), ou bien avec un « déambulateur » (gag 10A page 37), ou encore un lance-flamme (gag 285 page 209) en présence de verglas.
A ce tableau déjà bien fourni, on peut ajouter que les complications musculo-squelettiques et les probables luxations/subluxations articulaires sont bien présentes dans l’histoire de Gaston, comme en témoignent ses nombreuses immobilisations par plâtre et autres passages à l’hôpital : par exemple, une fracture ou une luxation du poignet gauche après avoir voulu cassé un biscuit lors d’un entrainement de karaté (gag 418b page 314), ou une noix (gag 539b page 451). Enfin, son hypermobilité articulaire semble familiale, si l’on en croit les dessins de l’oncle de Gaston (page 909) et de son neveu (page 909, publicité pour dilektron® parue dans le Spirou n°1805, et « Gastoon » aux éditions Marsu production).
Un fort faisceau d’arguments
Avant dernier indice sur lequel s’attarder : les nombreuses onomatopées qu’utilise Gaston pour exprimer des phénomènes douloureux, allant de « Aïe !Aïe ! » à « Gargll RRâââââh » ou « AOUHH » sont présentes de manière régulière dans tous les albums. « M’enfin »… on peut difficilement en conclure que notre garçon de bureau présente des douleurs chroniques quotidiennes depuis plus de 3 mois. De plus certains auteurs rapportent dans le SEDh une frilosité dont souffre aussi Gaston. Ainsi explique-t-il que le « froid l’engourdit » (gag 273 page 203), ce qui qui le pousse à utiliser de nombreux gadgets pour se réchauffer (gag 380 page 267).
Pour terminer, dans les antécédents médicaux connus de Gaston, on retiendra une simple allergie au mot « effort », diagnostiqué dans un gag (le 422b page 318). Il n’y a pas d’autres éléments qui nous conduisent sur la piste d’autres maladies. D’autant que rien ne nous permet de suspecter une maladie auto-immune rhumatologique, ou une pathologie neuromusculaire. Et il n’y a pas davantage de fragilité excessive de la peau (même à l’épreuve des flammes et autres traumatismes et brûlures chimiques) pouvant nous orienter vers une autre forme de SED. Enfin, on ne doutera pas du fait que Gaston ne présente probablement pas de troubles somatoformes.
Pour conclure, si faute de test génétique disponible et d’un examen clinique bien conduit il est impossible de conclure avec certitude à la présence d’un SEDh chez Gaston, nous avons un fort faisceau d’arguments pour penser que notre antihéros souffrait d’un tel syndrome, ou à tout le moins d’une hypermobilité articulaire importante.![]()
Mickaël Dinomais, Professeur de médecine en Médecine Physique et Réadaptation, Université d’Angers
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Crédit Image : meunierd / Shutterstock.com