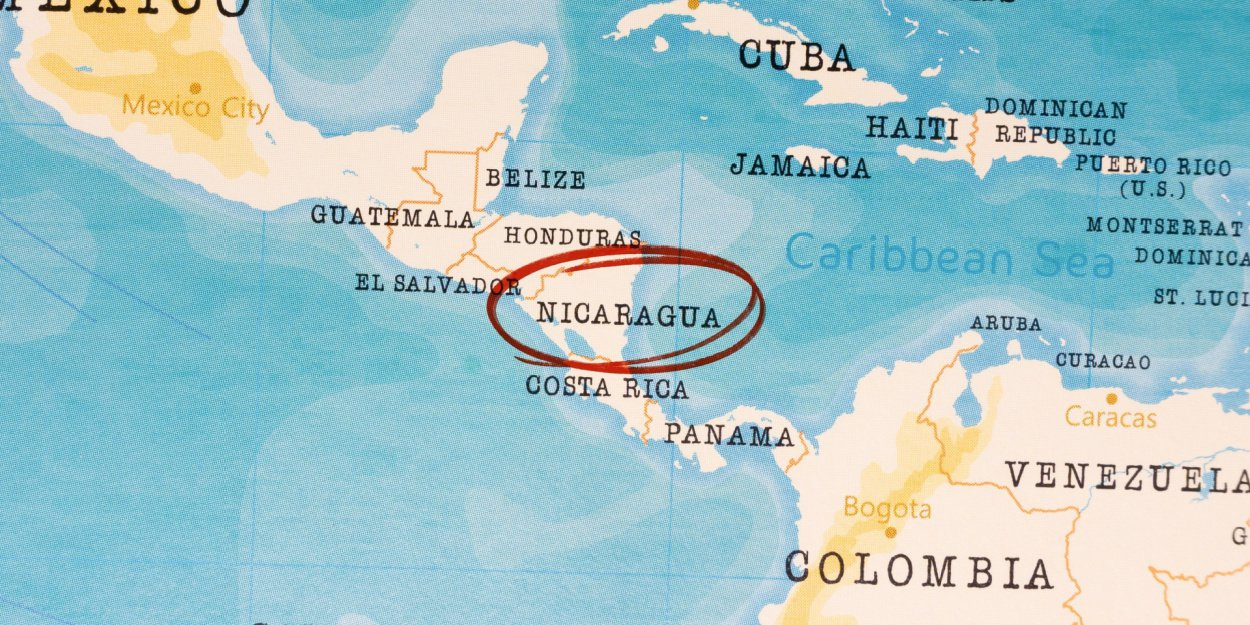Quelle était la place de Charlie Kirk au sein de la galaxie trumpiste ?
C’était avant tout – mais pas exclusivement, tant s’en faut – l’un des principaux porte-voix de Donald Trump auprès de la jeunesse. S’il a été assassiné à un âge très jeune, cela faisait déjà longtemps qu’il était bien connu des Américains.
En 2012, avant même d’avoir vingt ans, au moment où Barack Obama était en train d’achever son premier mandat et s’apprêtait à effectuer son second, il avait créé Turning Point USA, une organisation destinée à rassembler les étudiants conservateurs, et qui a rapidement obtenu les faveurs de nombreux riches donateurs. Kirk n’a pas terminé ses études ; il s’est lancé à corps perdu dans la politique. Les financements de TPUSA, dont Kirk est resté le président jusqu’à sa mort, n’ont cessé de croître au cours des années suivantes et l’organisation a pris une grande ampleur, cherchant notamment, à travers son programme "Professor Watchlist", à répertorier et à dénoncer les enseignants universitaires jugés trop à gauche.
Kirk a été repéré par les trumpistes et, s’il n’était au départ pas convaincu par le milliardaire new-yorkais (il était plutôt proche du Tea Party), il s’est vite totalement fondu dans son mouvement, se rapprochant nettement de son fils, Donald Trump Junior, et participant activement aux campagnes de 2016, 2020 et bien sûr 2024.
Il a joué un rôle non négligeable dans la victoire de Trump contre Kamala Harris, notamment grâce au succès de ses nombreuses tournées sur les campus, où il aimait à polémiquer publiquement avec des étudiants aux idées contraires aux siennes. Il faut d’ailleurs lui reconnaître un certain courage : il n’a jamais hésité à aller se confronter au camp opposé. Et comme il avait indéniablement un grand sens de la répartie et savait très bien mettre ses adversaires en colère et les cueillir d’une petite phrase bien sentie, ses duels oratoires ont donné lieu à de nombreuses vidéos virales qui ont eu un grand succès sur le Net parmi les jeunes de droite et, aussi, auprès de certains qui s’interrogeaient encore.
Au-delà de ces tournées, ses messages — diffusés par de nombreux moyens, mais avant tout par le biais de son très populaire podcast, le "Charlie Kirk Show" — ont eu un impact indéniable sur une jeunesse conservatrice qui se sentait souvent en minorité dans le monde universitaire.
Un peu comme les militants de la campagne Obama de 2008, il a consacré une grande partie de ses efforts à convaincre les jeunes qui n’étaient pas inscrits sur les listes électorales à s’enregistrer – et donc à voter Trump. Et une fois la victoire de Trump obtenue en novembre 2024, il a continué à soutenir sans relâche le président. Comme une partie considérable du mouvement MAGA, il a un peu fait la moue quand Trump a déclaré que le dossier Epstein — dont ses partisans attendaient qu’il en révèle le contenu, supposément explosif pour les démocrates — était vide. Mais il s’est vite rangé derrière le président sur ce point.
Sur le fond, son positionnement était assez classique au sein du monde trumpiste : ultra-conservatisme sur les questions sociétales (dénonciation des lois favorables aux personnes LGBT et de l’affirmative action, assimilation de l’avortement à un meurtre), religiosité portée en bandoulière (il était un fervent chrétien évangélique), hostilité assumée à l’immigration (systématiquement comparée à une invasion) et à l’islam, climato-scepticisme, rejet des mesures sanitaires prises pour endiguer la pandémie de Covid-19, grande perméabilité à diverses thèses complotistes, refus de la moindre entrave au port d’armes, alignement sur Israël, mansuétude voire sympathie à l’égard de Vladimir Poutine, etc.
Sur la forme, il avait été très inspiré par Rush Limbaugh, le fameux animateur de radio de droite radicale, très influent durant plusieurs décennies passés, volontiers clivant et provocateur, et à qui il a rendu un hommage appuyé quand ce dernier est décédé en 2021.
Dans sa réaction postée peu après l’annonce de la mort de Kirk, Donald Trump n’a pas hésité à en imputer la responsabilité à la gauche radicale, et à rapprocher ce qui venait de se produire non seulement de la tentative d’assassinat qui l’avait visé lui-même le 13 juillet dernier, mais aussi de celle commise contre l’élu républicain Steve Scalise en 2017 et, peut-être plus inattendu, de l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare Brian Thompson à New York en décembre dernier, et des actes de violence à l’encontre de certains agents de ses services de lutte contre l’immigration illégale (ICE) lorsque ceux-ci arrêtent des migrants supposément clandestins…
Il a parlé de ces actes de violence-là, mais il n’a pas évoqué le tout récent meurtre d’une élue démocrate du Minnesota et de son époux par un homme qui avait sur lui une liste d’élus démocrates à abattre.
Trump présente l’assassinat de Kirk non pas comme le produit de l’ambiance que l’on perçoit aujourd’hui dans le monde politique des États-Unis, et dont les représentants de tous les bords politiques sont les cibles de façon récurrente, mais uniquement comme la traduction en actes concrets des discours virulents dont les trumpistes font l’objet de la part de leurs adversaires – militants politiques et médias "mainstream" confondus. Ce faisant, et comme il fallait s’y attendre de sa part, il élude totalement sa propre responsabilité dans la déréliction de ce climat politique.
Trump n’est évidemment pas le premier politicien du pays à tenir un discours très agressif à l’encontre de ses opposants, mais jamais un président ne s’était exprimé comme il le fait chaque jour, avec une violence verbale constante encore soulignée par ses postures martiales et son recours récurrent aux messages en majuscules sur les réseaux sociaux. Cette manière de s’exprimer a largement infusé le débat public – cela dans le contexte de l’explosion des réseaux sociaux, propices comme chacun sait à la mise en avant des messages les plus virulents.
Les partisans de Trump, qu’il s’agisse de dirigeants politiques de premier plan ou d’éditorialistes de droite dure, rivalisent donc de formules à l’emporte-pièce. On l’a encore vu ces dernières heures après la mort de Kirk, quand des personnalités comme Elon Musk, Laura Loomer, Steve Bannon et bien d’autres ont appelé à la vengeance et dénoncé non seulement la gauche radicale mais aussi la gauche dans son ensemble, Musk tweetant par exemple que "la gauche est le parti du meurtre" – soulignons à cet égard que les trois anciens présidents démocrates toujours en vie, à savoir Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden, ont tous trois condamné avec la plus grande fermeté l’assassinat de Kirk, et que des leaders de la gauche du Parti démocrate comme Bernie Saunders, Alexandria Ocasio-Cortez ou encore Zohran Mamdani en ont fait de même.
Pour autant, et même si aucune personnalité de premier plan ne s’est réjouie de la mort de Kirk, la gauche n’est évidemment pas immunisée contre ce durcissement, cette radicalisation du discours, cette trumpisation du discours en fait, qu’on observe parfois sous une forme ironique, comme quand le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, reprend les codes de communication de Trump, mais qui prend aussi, sur les réseaux et dans certaines manifestations, des tonalités extrêmement agressives. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Trump a mentionné le meurtre de Brian Thompson par Luigi Mangione, un meurtre que certaines voix se revendiquant de la gauche radicale ont salué.
Les trumpistes ont beau jeu de se scandaliser des formules les plus excessives du camp d’en face, assimilé à une meute violente ; les adversaires de Trump, sous l’effet de cette intensification des débats, répondent avec encore plus de virulence ; c’est un cercle vicieux qui imprègne les esprits. Et bien qu’on ne sache rien à cette heure de l’identité du tireur, il faut souligner que cette hystérisation, cette colère mutuelle, a nécessairement des effets sur le grand public, y compris sur les nombreuses personnes ayant des problèmes psychiatriques et susceptibles de passer à l’acte – l’homme qui a essayé de tuer Trump en juillet dernier avait d’ailleurs ce profil.

Tout cela a des traductions très concrètes. L’année dernière, une étude du Brennan Center a montré que le nombre de menaces visant des personnalités politiques, locales ou nationales, avait triplé entre 2017 et 2024. Les élus, mais aussi les militants politiques, à tous les niveaux, ainsi que les juges, ont peur. Entre 2020 et 2024, 92 % des élus ont pris des mesures de sécurité supplémentaires pour réduire les risques pesant contre eux-mêmes et contre les processus électoraux. Le climat est plus délétère que jamais.
Le contexte que vous décrivez est d’autant plus crispé que Donald Trump est actuellement dans une confrontation ouverte avec plusieurs villes et États dirigés par des démocrates, où il fait intervenir l’armée afin de mener à bien ses procédures d’expulsion, et aussi en tension maximale avec de nombreux juges de divers niveaux, jusqu’à la Cour suprême, du fait de ses tentatives de s’arroger toujours plus de prérogatives. Au vu des appels à durcir le ton face à la gauche venus du camp républicain, est-il envisageable que la mort de Kirk soit le prétexte invoqué pour adopter de nouveaux décrets qui donneraient au président encore plus de pouvoir ?
C’est loin d’être impossible. Trump a du mal à faire passer de nouvelles lois – il faut pour cela disposer de 60 sièges au Sénat, ce qui n’est pas le cas. Mais il use et abuse des décrets présidentiels. Ceux-ci peuvent être contestés en justice, mais en attendant, il les met en application. Il est déjà tourné vers les élections de mi-mandat qui auront lieu dans un an, et il peut instrumentaliser ce meurtre pour, par exemple, au nom de la supposée menace exceptionnelle que la gauche fait peser sur le pays, interdire des manifestations, arrêter des gens encore plus facilement qu’aujourd’hui, les menacer de peines sévères en cas de résistance à la police, et ainsi de suite. La présence de militaires dans certaines villes, de ce point de vue, n’a pas grand-chose de rassurant.
Charlie Kirk aura alors en quelque sorte autant servi les projets de Trump dans sa mort que dans sa vie…
Tout assassinat est un drame, et quoi qu’on puisse penser des idées de Kirk, et bien que lui-même disait mépriser le sentiment d’empathie, cet assassinat-là n’échappe évidemment pas à la règle. Mais effectivement, ce ne serait pas la première fois qu’un pouvoir radical utiliserait le meurtre de l’un de ses partisans pour justifier son propre durcissement, le renforcement de ses prérogatives et sa répression à l’encontre de ses adversaires politiques.
Ce qui est sûr, c'est que Trump ne lésine pas sur les symboles. La Maison Blanche a ordonné que, en sa mémoire, les drapeaux soient mis en berne dans tout le pays, ainsi que dans les ambassades ou encore sur les navires en mer. Avec Kirk, le trumpisme tient un martyr — c’est le mot de Trump, qui l’a qualifié de "martyr de la liberté" — parfait. L’homme était une sorte d’idéal-type du trumpisme : jeune, beau, blanc, charismatique, marié, deux enfants, self-made man, ultra-patriote, chrétien très pratiquant…
Quand Trump dit que le nom de Charlie Kirk ne sera pas oublié de sitôt, il dit sans doute vrai : lui-même et l’ensemble du monde MAGA avaient déjà leur image héroïque avec cette photo impressionnante du 13 juillet sur laquelle Trump, ensanglanté, brandit le poing après le tir qui a failli lui coûter la vie. Il est fort à parier que l’image de Charlie Kirk parlant au pupitre quelques instants avant d’être tué rejoindra cette photo iconique au panthéon du trumpisme…
Propos recueillis par Grégory Rayko
Jérôme Viala-Gaudefroy, Spécialiste de la politique américaine, Sciences Po
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.